Nos maîtres






![Notices envoyées par Jacques Prevosto [plus bas sur cette page, Jean Lacroix]
(Sur L.-Th. Achille cliquer ici)
Sur Pillard, qui s’était retiré à Crest, un de ses anciens élèves, André Poizat, écrit :
« Jean Pillard nous a quittés sans le faire savoir. Cela lui ressemble […] Fils unique, célibataire, il trouvait, sans doute, dans l’humanisme antique plus qu’une distraction ou qu’un métier : une compagnie à sa solitude. Mais il n’en parlait pas. Il était de ceux que les langues mortes font vivre. C’était la science alliée à la pudeur et à la modestie ; ce n’est pas celle qui fait le plus de bruit. C’est pourquoi il n’humilia jamais personne, il ne considéra jamais un latiniste médiocre comme un imbécile inutile à la planète. Ce respect des autres le rendait respectable à tous ses élèves, autant que sa science le rendait admirable. »
Alfred Rambaud par Jacques Prevosto
Alfred Rambaud, professeur d’histoire de 1961 à 1984 (texte paru dans Vara, tibi Khagna. Être khâgneux à Lyon 1901-2001, publié par la Khagna Lugdunensis Tribus Veterum)
La doxa khâgnale n’a rendu justice à Alfred Rambaud que tardivement et, sans doute, incomplètement. En 1961-1962, ses premiers élèves, qui avaient connu les fulgurances de Père Joseph (Hours), affectèrent de ne voir dans les cours du nouveau professeur d’histoire que superficialité et platitude. Leurs épigones s’en tinrent, très majoritairement, à ce jugement et ne voulurent retenir que des cuirs et des liaisons malencontreuses, pour des imitations plaisantes lorsqu’elles n’étaient pas trop répétées. Après 1968 ce fut bien pis. Parce qu’il était gaulliste tendance Raymond Aron, Alfred Rambaud fut condamné pour fascisme par les petits Saint-Just de toutes les chapelles gauchistes (en accord, sur ce point, avec les derniers fidèles de l’église communiste orthodoxe). Ses cours furent jetés, et pas toujours métaphoriquement, aux poubelles de l’histoire : il est vrai que, sur l’URSS des années 1920 et 1930, il osait présenter alors ce qui figure aujourd’hui, dans n’importe quel manuel de Permière et que, pour traiter de la Chine maoïste, il s’éloignait sensiblement des pastorales de Maria Antonietta Macciochi (mais qui se souvient encore de Maria Antonietta Macciochi ?). Au milieu des années 1970, tout de même, dans une khâgne apaisée (par l’arrivée des jeunes filles ?) on commença à dire que « sous la triple » - et jaurésienne – « inspiration de Marx, de Michelet et de Plutarque » Alfred Rambaud préparait consciencieusement et efficacement aux épreuves d’histoire des concours d’entrée aux Écoles Normales Supérieures d’Ulm et de Sèvres. Quelques khâgneux l’avaient compris dès les années 1960 : mais l’avaient-ils assez dit, le lui avaient-ils assez dit ? Là est mon secret remords, qui m’a fait accepter, en dépit de mon peu de goût pour la khâgnolâtrie, d’écrire ces lignes. Elles me permettent de témoigner pour toutes celles et pour tous ceux qui ont été marqués par le style Rambaud, caractérisé par un travail énorme et une réflexion profonde, cachés l’un et l’autre avec une souriante coquetterie. Pour parachever ce témoignage, je ne peux mieux faire que de citer l’Archicube Péguy, dans l’Argent :
« Cette grande bonté, cette grande piété descendante de tuteur et de père, cette sorte d’avertissement constant, cette longue et patiente et douce fidélité paternelle, un des tout à fait plus beaux sentiments de l’homme qu’il y ait dans le monde, je l’avais trouvée tout au long de cette petite école primaire annexée à l’école normale d’instituteurs d’Orléans. Je la retrouvai à Lakanal éminemment chez le Père Edet… Je la retrouvai à Sainte-Barbe. Je la retrouvai Louis-le-Grand, notamment chez Bombard… C’est dire par conséquent que le plus beau métier du monde après le métier de parent (et d’ailleurs c’est le métier le plus apparenté au métier de parent) c’est le métier de maître d’école et c’est le métier de professeur de lycée. Eux seuls ont des élèves. Les autres ont des disciples. »
Victor-Henry Debidour par Jacques Prevosto
Texte rédigé pour le Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’ENS, 1989, et repris dans Victor-Henry Debidour : 1911-1988. Saveur des lettres, saveur du maître, [témoignages recueillis par l’]Association des amis de Victor-Henry Debidour, Éditions lyonnaises d’Art et d’Histoire, 1990.
Lorsqu’en 1965 venu de Brest ma ville natale je découvris la khâgne lyonnaise, alors illustre, le nom du maître de français et de grec m’était depuis longtemps familier. Mon père avait en effet acheté la Sculpture bretonne de Victor-Henry Debidour dès sa parution en 1953 chez un de ces modestes éditeurs de province où se découvrent les talents, Plihon à Rennes. Le livre figurait en bonne place dans la bibliothèque familiale et en sortait fort régulièrement, tantôt pour proposer à mes sœurs des dictées de vacances, plus souvent pour faire découvrir à un visiteur les trésors cachés de la Bretagne. Car Victor-Henry Debidour, en Bretagne, comme dans les autres provinces parcourues pendant les vacances, empruntait les routes départementales de préférence aux nationales, les chemins vicinaux de préférence aux départementales sans hésiter à s’engager dans les chemins creux. Il découvrait ainsi, à tous les sens du terme parfois, chapelles et calvaires dont la description prenait place dans des carnets (en Bretagne) ou des cahiers (tenus par Madame Debidour pour les autres régions) et dont les photographies s’inséraient dans un ensemble devenu considérable au fil des ans. Tout cela a nourri de nombreux ouvrages à la suite de la Sculpture bretonne : Brève histoire de la sculpture chrétienne (1960), Trésors cachés du pays niçois (1961), Bestiaire sculpté du Moyen Âge en France (1962), Auvergne (en collaboration avec Bernard Plessy, 1976), L’art de Bretagne (1979). Mais ce que cherchait Victor-Henry Debidour dans ces pérégrinations ce n’était certes pas une documentation érudite, c’était sans doute une émotion esthétique, c’était surtout une communion avec un monde dont il ne put sans doute jamais se faire à l’idée qu’il ne fût plus le nôtre, un monde de paysans porteurs de la tradition catholique que le jeune normalien avait retrouvée après s’être détourné de la religion républicaine du Progrès, celle de son grand-père et de son père. La ville, lieu d’une modernité refusée, ne le retenait jamais longtemps et il faisait sans doute siens ces mots du Justinot d’Aristophane : « la ville, je la déteste, c’est mon village que je regrette ». De là l’attrait pour l’arrière-pays niçois, l’Auvergne et surtout la Bretagne ; de là la préférence nettement accordée au roman sur le gothique. Michel Debidour m’a révélé que son père venu le voir en Grèce, où il ne s’était jamais rendu auparavant, dédaigna l’Acropole pour lui préférer la solitude de Vassae. Que ce monde que nous avons perdu fût plus mythique que réel il en avait sans doute conscience sans en avoir cure car il entretenait avec l’histoire, que son grand-père avait illustrée, des rapports distants comme en témoigne cette phrase de l’avant-propos de la Sculpture bretonne : « Il faudrait, il faudra, pour expliquer l’art breton, de longues études de géographie humaine, d’histoire politique, sociale, religieuse, de critiques hagiographiques et folkloriques… il n’était ni de ma compétence, ni de mon goût de m’enfoncer dans ce chemin. »
Si la Bretagne gagna le cœur de Victor-Henry Debidour, elle ne le retint guère comme professeur : il ne resta qu’un an dans son premier poste de Quimper avant de gagner Avignon puis le lycée du Parc à Lyon où, nommé au moment de son départ en retraite en 1971, c’est-à-dire douze cents à quinze cents élèves, c’est-à-dire quinze à dix-huit mille dissertations – vous savez bien, de ces dissertations sur des sujets impossibles et qui vous conduisaient à des développements qui valaient parfois mieux par leurs intentions que par leur mise au point… quinze mille à dix-huit mille versions grecques – vous savez bien ces Thucydide où vous plaidiez avec une conviction malicieuse que, cet historien ayant souvent des phrases obscures, c’était le traduire selon son génie et ses intentions que de le rendre en un français… obscur. » Pendant ces trente-trois années Victor-Henry Debidour se voulut d’abord un professeur ou, plus exactement, pour reprendre l’affectueuse terminologie khâgnale, un maître qui ne désirait rien tant que d’être un serviteur inutile : « Les khâgneux, m’écrivait-il en janvier 1970, n’ont pas tant à m’être reconnaissants. D’abord parce que je ne faisais que mon métier… Ensuite, parce que tout khâgneux digne de ce nom s’est toujours formé lui-même, devant ses maîtres. Ἐπαιδεύσατο au moyen, s’est donné une formation, non pas Ἐπαιδεύθη au passif. Reste qu’il fallait cependant de toute nécessité qu’il y eût des maîtres avec qui, envers et contre qui, cette formation pût s’acquérir… Et c’est là qu’apparaît cette définition paradoxale que j’ai toujours conçue de ma tâche, celle d’être un serviteur inutile et pourtant indispensable (dans mon ordre), comme le catalyseur en chimie. » Qui veut se faire une idée de ce qu’était un cours de Victor-Henry Debidour (mais il y manquera le ton saccadé et parfois haletant, le mouvement des mains et de l’être tout entier) peut ouvrir le livre qu’il fait paraître en 1946 et dont le titre résume les ambitions pédagogiques de l’auteur, Saveurs des Lettres. Le maître entraînant ses auditeurs dans une spirale de questionnements de plus en plus acérés et d’intuitions de plus en plus affinées (« bidourique », avions-nous coutume de dire) pour leur faire goûter le je-ne-sais-quoi qui est au cœur d’une œuvre ou d’un problème littéraire, et les laisser continuer ensuite seuls le chemin. Faire goûter, c’est aussi la tâche qu’il s’assignait comme traducteur : il y réussit admirablement avec son Aristophane qui, comme l’a écrit Jean-Claude Carrière, « fait de lui le continuateur des plus célèbres traducteurs français des grandes œuvres grecques, Amyot, Madame Dacier, Paul-Louis Courier, Paul Mazon. » Lorsque parut le premier tome, les hypokhâgneux lyonnais dont j’étais, après s’être délectés à la lecture de leur exemplaire, dûment dédicacé un mémorable après-midi de janvier 1966, se demandèrent où et pourquoi, à l’ordinaire, leur maître dissimulait la verve et la truculence qui éclataient à toutes les pages : y aurait-il eu un deuxième Debidour, qui, chronologiquement, comme me l’a suggéré Henri Queffélec, aurait été le premier ?
En relisant, pour les besoins de cette chronique, l’Aristophane par lui-même, (1962), qui constitue une introduction à la traduction, je suis tombé sur ces lignes qui me paraissent pouvoir assez bien évoquer les sentiments de Victor-Henry Debidour à la fin de sa carrière : « Aristophane de son côté, avec l’âge, semble se décourager à la fois dans ses espoirs, dans ses convictions et dans ses haines : le bon vieux temps ne reviendra plus, non seulement bien sûr la radieuse Athènes des guerres médiques, mais même la cité militante qui orientait si mal son patriotisme ou son enthousiasme littéraire mais qui méritait encore qu’on lui dît ses vérités. » À la fin des années 1960, les Lettres qu’on enseignait à Paris avaient pour Victor-Henry Debidour un drôle de goût. Mais il pouvait encore ignorer « les élucubristes, les devins scabreux » (Aristophane, Nuées). Par contre, les événements de 1968, je puis en témoigner, touchèrent cet hypersensible au cœur : la khâgne, sa khâgne lui avait manqué. « Je pars aussi, sinon parce que, du moins au moment où, quelque chose a été fêlé. Cela, je le sentais venir peu à peu. Cela a éclaté le jour où, venant faire classe, j’ai trouvé la porte de la salle fermée, loquet enlevé. Je m’enquis. Un de mes élèves me dit : « C’est moi », - « Pourquoi ? » - « Parce que nous avons décidé la grève » - « Quel rapport y a-t-il entre l’idée que vous vous faites de la société d’aujourd’hui ou de demain et le fait d’assister à ma classe de français ? » - « Le rapport le plus étroit. » Après avoir quitté une khâgne qu’il ne reconnaît plus, Victor-Henry Debidour se consacra encore un peu plus au Bulletin des Lettres. Il faut être lyonnais pour connaître cette institution dont, comme toutes les institutions lyonnaises, le sérieux et le poids est proportionnel à la discrétion. Rédacteur en chef pendant quarante ans de cette « revue de critique et d’information bibliographique », Victor-Henry Debidour en était aussi le principal, sinon l’unique, rédacteur tout court, refusant de se spécialiser dans ses spécialités pourtant nombreuses. Mais au début des années 1980, la librairie Lardanchet qui publiait le Bulletin dut fermer ses portes et Victor-Henry Debidour n’eut plus cette chaire qui avait complété puis remplacé la chaire khâgnale. D’autre part, les éditions du Seuil, pour qui il avait traduit les tragiques grecs « en pendant à Aristophane et en hommage (partiellement) de réparation à Euripide », ne se souciaient guère de faire paraître le manuscrit, après l’arrêt de la collection « L’Intégrale » à laquelle il était destiné. Alors Victor-Henry Debidour s’enfonça peu à peu dans la nuit, celle de Saint Jean de la Croix, jusqu’à ce jour de juin 1988 où la Lumière qu’il avait discernée adolescent l’enveloppa pour l’éternité. Comment ne pas lui laisser une dernière fois la parole ? « Je voudrais vous soumettre pour finir une certaine idée que je me fais, non pas de l’avenir, mais de l’éternité. Oui, rien que ça. Je me demande si notre fin dernière n’est pas tout simplement ceci : que chacun de nous sera appelé ou condamné à posséder ce à quoi il se sera voué… « C’est cela que tu as aimé, c’est à cela que tu t’es attaché ? Eh bien, tu l’as »… Est-ce que cela ne pourrait pas se dire « tu l’as aimée, hein, ta khâgne ? eh bien, tu l’as »… Si je vous disais que le paradis, pour moi, professeur, pour moi traducteur, c’est un univers où je n’aurai plus qu’à me taire, parce qu’il n’y aura plus ni contresens, ni barbarisme, ni faux-sens, vous jugerez que c’est vraiment le comble de la déformation professionnelle. Peut-être. Mais au sens où je prends ces mots, c’est-à-dire offense à la vérité, attentat à la beauté, incapacité de compréhension d’autrui, ce n’est peut-être pas si absurde. »](Maitres_files/shapeimage_3.png)

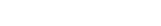
Notice extraite du Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, vol. 6, Lyon - le Lyonnais - le Beaujolais, Sous la direction de X. de Montclos Beauchesne (éditeur), 1994. et recopiée depuis le site La page de Jean Lacroix.
Jean LACROIX - Philosophe, membre correspondant de l'Institut (Lyon 23.12.1900 - 27.06.1986).
Né dans une famille bourgeoise catholique, jean Lacroix fait ses études secondaires au collège dominicain d'Oulins, puis au collège jésuite de la rue Sainte-Hélène. Il s'inscrit aux Facultés catholiques de Lyon, et obtient la licence ès lettres et la licence en droit. Il se tourne ensuite vers la philosophie et présente un mémoire de DES à Grenoble, sous la direction de Jacques Chevalier : il entrera ensuite dans le " groupe de travail en commun " fondé par Chevalier avec le concours de Jean Guitton. Il s'inscrit en Sorbonne, où Brunschvig l'initie à l'idéalisme, et il obtient l'agrégation de philosophie en 1927. il fait la connaissance de Laberchonnière et fréquente, avec Guitton, le groupe des Davidées de Mlle Silve, où il rencontre Emmanuel Mounier en 1928.
Nommé professeur au lycée de Dijon, il est associé aux préparatifs du lancement de la revue Esprit et décide de s'engager aux côtés de Mounier. Il fonde à Dijon l'un des premiers et des plus vivants groupes Esprit, dans lequel il réunit des gens divers, jeunes et enseignants notamment, chrétiens et socialistes. Puis Lacroix retrouve Lyon où, de 1937 à 1968, il fut professeur dans les classes préparatoires de lettres supérieures et de première supérieure du lycée du Parc.
On peut dire de son enseignement - très efficace pour la réussite au concours de l'école normale supérieure, notamment pour les élèves non philosophes - qu'il était classique par sa facture et moderne par son ouverture à tous les courants de la pensée contemporaine, de l'existentialisme au structuralisme, du marxisme à la psychanalyse.
Le sens du dialogue qui le caractérise ne le conduit en rien à l'abandon de ses propres convictions : Lacroix, d'abord influencé par Laberthonnière et par Blondel, resta, tout au long de son oeuvre, fidèle à un personnalisme ouvert.
Depuis qu'il est de retour dans la région lyonnaise, Lacroix est entré dans l'intimité intellectuelle et spirituelle du P. Albert Valensin, professeur de théologie aux Facultés catholiques, disciple et ami intime de Maurice Blondel. Il devient membre de la Société lyonnaise de Philosophie, animée par l'ancien silloniste Victor Carlhian et par Auguste Valensin. Il y rencontre Vialatoux. Il est en outre l'animateur du groupe Esprit de Lyon, qui sera le principal foyer du mouvement en province.
Lacroix fut membre du comité directeur de la revue jusqu'à la mort de Mounier en 1950 et le resta au temps de la direction d'Albert Béguin (1950-19e. Ses nombreux articles dans la revue concernent surtout la réflexion politique, les socialismes et le syndicalisme, le rôle du droit, la démocratie, les communistes, la responsabilité des chrétiens. Il collabore, en 1938-1939, au Voltigeur, feuille politique bimensuelle, lancée par l'équipe d'Esprit au lendemain de Munich. C'est à Lacroix que fut confiée la tâche, dans le célèbre numéro spécial d'Esprit sur le marxisme (mai-juin 1948), de dégager la ligne de la revue, ce qu'il fit dans un article intitulé " Marx et Proudhon ", avec la clarté et l'esprit de synthèse qui distinguaient ses écrits.
De 1940 à 1942, il donne à l'Ecole nationale des Cadres d'Uriage une série de conférences sur la patrie, sur Péguy, Marx, et sur divers sujets de psychologie, de pédagogie et de morale. Cet enseignement contribue à orienter la démarche pédagogique et spirituelle de l'équipe d'Uriage vers la Résistance, et vers une révolution sociale et humaniste.
En 1945, Hubert Beuve-Méry lui confie la chronique mensuelle de philosophie dans le journal Le Monde. Lacroix s'acquittera régulièrement de cette tâche jusqu'en 1980. Ses articles ont été rassemblés dans une série intitulée Panorama de la philosophie contemporaine (1968, 1990).
Jean Lacroix fut un participant actif de la Chronique sociale et des Semaines sociales de France, non seulement par les articles et les conférences qu'il donna à ces deux institutions d'origine lyonnaise (huit cours aux Semaines sociales entre 1936 et 1964), mais par une coopération efficace à l'élaboration des projets et à la définition des orientations (il est membre de la commission générale des Semaines sociales à partir de 1945). Dès 1936, il joue un rôle médiateur entre les catholiques sociaux (Duthoit, les équipes de la revue Politique et de la Chronique sociale) et ses amis du mouvement Esprit qui préfèrent les engagements non confessionnels.
En 1947, son cours à la Semaine sociale de Paris sur " l'homme marxiste " fait sensation et provoque quelques remous. Il y donne l'exemple de l'attitude de " sympathie méthodologique " qui caractérise son approche des courants de la pensée contemporaine; il saura d'ailleurs maintenir constamment ouvert le dialogue, si difficile soit-il souvent, avec ses amis intellectuels communistes.
Ayant défendu, dès 1937-1938, l'option du syndicat SGEN, adhérent à la CFTC, il participe aussi, après 1945 surtout, au développement de la " Paroisse universitaire " (membres catholiques de l'enseignement public) ; rapporteur à plusieurs reprises aux " journées universitaires " annuelles, Il est aussi l'un des collaborateurs et amis du P. Dabosville, aumônier national de 1946 à 1963.
Lacroix donne également des conférences à la Société européenne de Culture, dirigée par Umberto Campagnolo. Il est souvent invité à l'étranger : des auditoires nombreux, en Belgique, en Suisse, au Canada, dans les pays du Maghreb, en Amérique latine, l'entendent s'exprimer sur les grandes questions auxquelles la société et l'homme moderne sont confrontés.
Ami des jésuites Varillon et Fraisse, et de Hubert Beuve-Méry, il entretient une correspondance assidue avec les personnalités les plus diverses, de ses collègues philosophes aux inconnus qui ont rencontré sa signature dans Le Monde. A Lyon, comme à Lépin-le-Lac (Savoie), il accueille avec convivialité de nombreux visiteurs. jouant avec humour de son aspect massif et maladroit, Lacroix s'est créé un personnage dont ses élèves ont fait un mythe inépuisable et réjouissant. Le paradoxe, l'ironie et la répétition des formules fortement frappées lui servent à exprimer une pensée aussi nourrie de lectures et de références savantes que de l'expérience et de la culture du quotidien.
Lacroix est un philosophe personnaliste, c'est-à-dire que, pour lui, le centre de tout est la personne humaine, spirituelle et incarnée. Cette personne ne peut trouver de sens à sa propre liberté intérieure que par la relation à l'autre. Elle ne peut être elle-même que dans l'engagement social, au sein de la famille comme au sein de l'humanité entière. Et Dieu est le seul Autre qui puisse fonder la réalité du sujet distinct, du " moi ", et lui donner de s'ouvrir aux autres pour former un " nous ". Cette dialectique que Lacroix exprime tour à tour en métaphysicien et en moraliste, attentif à toutes les dimensions de l'expérience humaine, permet, selon lui, de dépasser à la fois le marxisme et l'existentialisme et de répondre à l'élan intégral de l'homme.
B. Comte et X. de Montclos

Voir aussi le discours de Gérard Collomb pour le Centenaire de la Khâgne de Lyon (15 décembre 2001)


